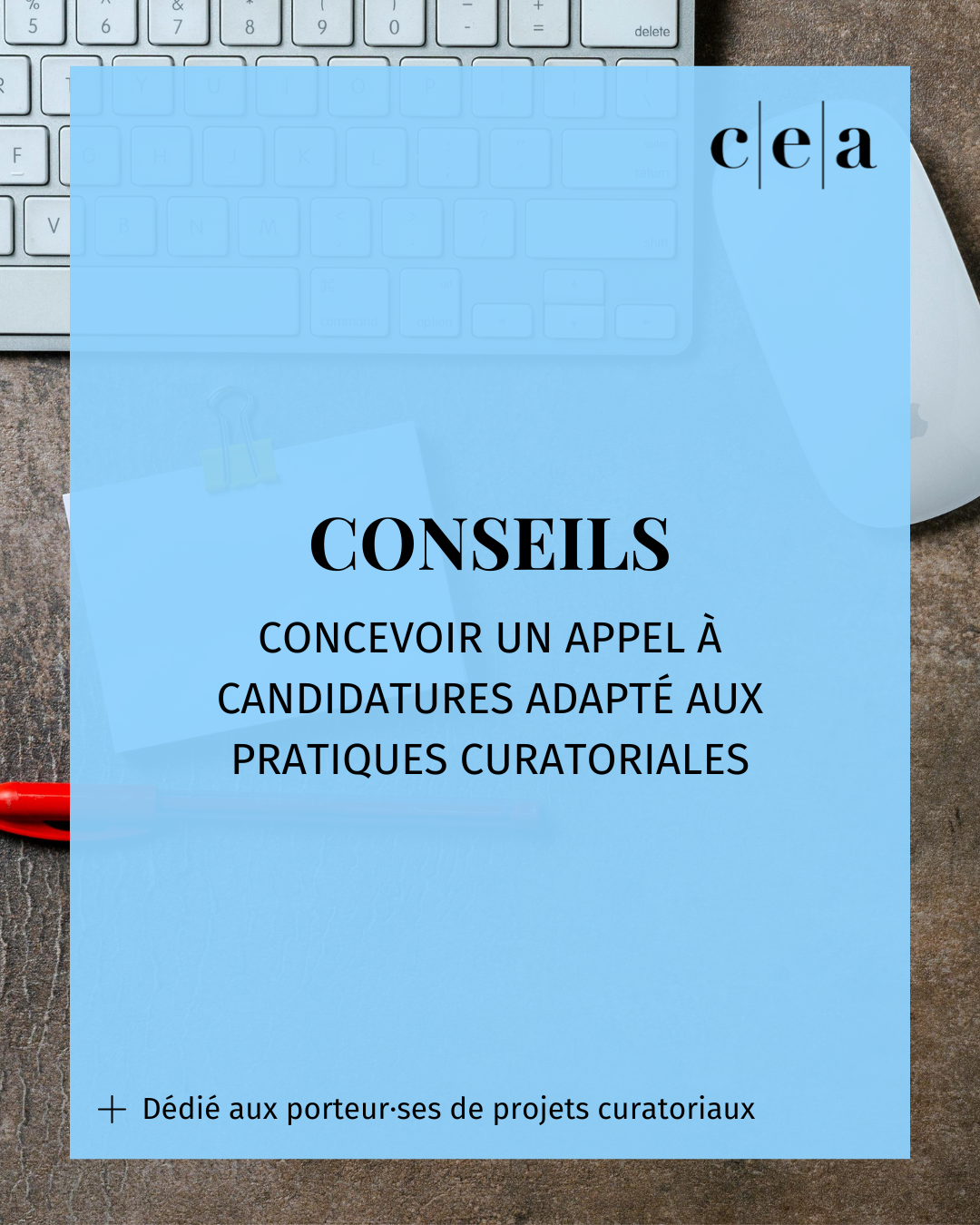CONTEXTE
C-E-A développe des conseils pour concevoir des appels à candidatures tenant compte des réalités du métier de commissaire d’exposition. Ces conseils visent à garantir un cadre clair, équitable et respectueux du travail demandé. Pour autant, chaque structure possède ses spécificités (missions, ressources, contraintes, temporalité…) et il convient d’adapter ces recommandations à son contexte propre. L’objectif de C-E-A est de proposer un cadre de référence, une opportunité pour améliorer les pratiques.
CONSEILS
-
Format de l’appel à candidatures
- Concevoir un appel en deux étapes pour les projets nécessitant un travail de réflexion et de projection :
- 1e partie : note d’intention synthétique, dossier léger sans trop de pièces à joindre par les commissaires d’exposition. Cette première partie ne demande pas l’engagement des répondant·es.
- 2e partie : pré-sélection d’environ 5 candidatures pour demander la constitution d’un dossier de candidature approfondi, incluant un texte présentant l’intention du projet, un budget prévisionnel, des pistes de réflexion artistiques (artistes/œuvres pressenti·es).
- 3e partie, selon la configuration du projet : entretien oral des personnes pré-sélectionnées.
- La 2e et 3e partie font l’objet d’une indemnité pour le travail fourni.
- Concevoir un appel simple constitué de pièces pré-existantes (CV, portfolios, biographies…) et d’une à deux pièces maximums additionnelles (lettre de motivation d’une page, note d’intention de 3 pages maximum…).
2. Modalités de candidature
- Processus de candidature clair et concis :
- Définir précisément les documents à fournir (CV, portfolio, note d’intention, proposition curatoriale succincte, etc.).
- Limiter la quantité de travail initial demandé. Une proposition curatoriale trop détaillée à ce stade peut représenter une charge de travail importante et non rémunérée pour les non-sélectionné·es. Privilégier une note d’intention ou un concept général dans un premier temps.
- Spécifier le format des documents si nécessaire (PDF, poids des documents, etc.).
- Indiquer clairement la date limite et le mode de soumission (email, plateforme dédiée).
- Envoyer un accusé de réception du dossier de candidature.
- Transparence sur le processus de sélection :
- Décrire les étapes du processus de sélection (présélection sur dossier, entretiens, présentation du projet).
- Indiquer la composition du jury ou du comité de sélection. Favoriser une composition diversifiée pour garantir la pluralité de regards et une meilleure impartialité. Rémunérer les membres du jury non salarié·es.
- Donner un calendrier indicatif pour le processus (date de présélection, date des entretiens, date de décision finale).
- Transparence et précisions sur les critères de sélection.
- Ne pas limiter à des tranches d’âge.
- Assurer la confidentialité des propositions des candidat·es et s’engager à ne pas utiliser les contenus des dossiers de candidature (note d’intention, projet d’exposition, liste d’artistes ou d’œuvres…) dans le cadre d’un projet, sans faire appel à l’auteur·rice du concept.
- Retour après la commission :
- Informer tou·tes les candidat·es, qu’iels soient retenu·es ou non, du résultat de leur candidature.
- Envisager de fournir un commentaire constructif aux candidat·es non retenu·es en phase finale, si sollicité·e. Cela montre du respect pour leur travail et les aide à s’améliorer.
- S’engager à mentionner le·la commissaire retenu·e sur l’ensemble des éléments de communication liés à son projet (qu’il s’agisse d’une exposition, d’un accompagnement artistique, d’une résidence ou autre).
3. Informations essentielles à fournir aux commissaires
- Contexte clair du projet :
- Présentation détaillée de la structure commanditaire (mission, valeurs, public cible, type d’événements habituellement organisés, équipe, …).
- Objectifs du projet (artistiques, culturels, éducatifs, etc.).
- Thématique ou ligne directrice si elle est déjà définie. Si l’appel est ouvert à des propositions libres, le préciser.
- Public visé par le projet.
- Accompagnement, soutien ou ressources disponibles auprès du·de la lauréat·e pendant toute la durée du projet.
- Ressources et contraintes :
- Budget global alloué au projet (même si certains postes sont gérés directement par la structure, cela permet au·à la commissaire de comprendre l’envergure et les moyens, modalités de défraiement s’il y a lieu).
- Lieu d’exposition (plan, photos, spécificités techniques : éclairage, accessibilité, cimaises, équipements disponibles).
- Calendrier prévisionnel détaillé du projet (de la phase de conception à l’accrochage et au démontage, voir la postérité du projet si approprié).
- Ressources humaines et logistiques disponibles (équipe technique, transport, médiation, communication, etc.).
- Contraintes spécifiques (techniques, budgétaires, thématiques, de conservation, de sécurité, etc.).
- En cas de résidence : Se reporter aux bonnes pratiques proposées dans le guide des résidences édité par le CNAP, disponible gratuitement sur leur site internet (permettre le fractionnement, pour ne pas pénaliser les commissaires parents notamment, prévoir ou annoncer les modalités d’accueil des familles, mettre en place une rémunération juste adaptée aux réalités de la résidence, etc.), et se référer aux ressources élaborées par Arts en Résidence (contrat, rémunération, vie familiale en résidence…)
- En cas de résidence : transmettre les éléments pratiques (commerces à proximités, modalité de prise en charge ou non des familles, information pratiques sur le lieu de vie de résidence et ses commodités, prise en compte des besoins des personnes en situation de handicap…)
- Attentes spécifiques :
- Type de projet recherché (exposition monographique, collective, thématique, immersive, etc.).
- Nombre d’artistes ou d’œuvres envisagé·es (si applicable).
- Livraisons attendues du·de la commissaire (proposition curatoriale détaillée, liste d’œuvres, textes d’exposition, coordination avec les artistes, suivi de production, etc.).
- Relations et collaborations prévues avec l’équipe de la structure, les artistes, les partenaires, etc.
- Préciser la nécessité d’autonomie ou non, les obligations de présence sur place (rencontres préalables, phases de recherche ou de conception par exemple).
- Contacts et questions :
- Nom et coordonnées d’une personne référente pour toute question relative à l’appel à candidatures.
- Préciser les modalités pour poser des questions (email uniquement, session de questions-réponses collective, etc.).
4. Conditions de rémunération
- Contractualisation : Pour l’ensemble des collaborations, il est obligatoire de signer un contrat précisant les délimitations de chaque collaboration. Un contrat doit assurer une juste rémunération du travail des commissaires et lister précisément les différentes missions. C-E-A propose un modèle de contrat adapté au commissariat d’exposition, ainsi que des préconisations de rémunération. Le réseau Arts en Résidence met à disposition un modèle de contrat adapté aux résidences, dont les commissaires peuvent bénéficier. Le réseau propose également des conseils sur les rémunérations envisageables dans le cadre d’une résidence.
- Transparence absolue sur la rémunération :
- Indiquer clairement le montant de rémunération dès l’appel. Ne pas attendre les entretiens pour révéler ce point crucial.
- Indiquer le montant de la rémunération brute et hors taxes.
- Préciser si la rémunération est forfaitaire ou basée sur un taux horaire/journalier.
- Dissocier la rémunération des autres prises en charges (frais de déplacement, frais de recherche, etc.).
- Mentionner si des budgets additionnels sont prévus pour la production des œuvres des artistes collaborant au projet, leur transport, l’assurance, la communication, les frais de douanes, etc. (et en donner une estimation ou un mode de calcul si possible).
- Rémunération juste et équitable :
- Se baser sur les standards du secteur et les préconisations tarifaires existantes (commissariat d’exposition diffusé par C-E-A, écriture de texte diffusé par AICA France, rémunération des artistes diffusé par les réseaux territoriaux et DCA, bourse de résidence diffusé par Arts en Résidence, activités accessoires, etc.).
- Tenir compte de la complexité du projet, de l’ampleur du travail demandé et de l’expérience requise pour ajuster la rémunération.
- Proposer une rémunération qui valorise le temps et l’expertise du·de la commissaire. Ne pas cautionner les rémunérations symboliques ou les demandes de travail non rémunéré.
- Modalités de paiement claires :
- Établir et respecter un calendrier de paiement précis. Par exemple, un acompte au début du projet, des paiements intermédiaires basés sur des jalons, et le solde à la fin.
- Préciser les délais de paiement après réception des factures.
- Indiquer si des indemnités sont prévues en cas d’annulation du projet non imputable au commissaire.
- Prise en charge des frais :
- Clarifier la prise en charge des frais professionnels (déplacements pour les repérages, visites d’ateliers, per diem, transports d’œuvres, assurance, communication, etc.). S’ils sont remboursés sur justificatifs ou via note de débours, définir un budget maximum ou des modalités de validation.
- Éviter de demander aux commissaires de supporter des frais importants pour la conception d’un projet avant même d’être sélectionnés.
RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES